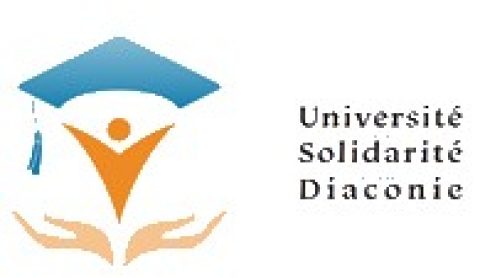Photo de couverture: Le Père Etienne Grieu a tiré l’enseignement théologique et spirituel de la rencontre | © Grégory Roth
Conférence d’Etienne Grieu. Voici le texte intégral de l’apport théologique du Père Etienne Grieu, sous forme de questions, d’analyse de passages bibliques et de pistes pastorales. Il nous le met à disposition pour que nous puissions poursuivre la réflexion.
Le texte en format PDF >> Conférence.pdf
Réécouter la conférence :
Introduction :
Je vais essayer de répondre à 3 questions :
- a) Quelle place la fraternité tient-elle dans la vie chrétienne ? S’agit-il d’un « petit plus », d’une option ? (quand il y en a, c’est très bien, mais s’il n’y en a pas beaucoup, ce n’est pas si grave) ou bien quelque chose d’essentiel pour l’Église et la vie chrétienne ?
- b) Quelle place pour les personnes en grande précarité, dans la communauté chrétienne ? Cette question est liée à une autre question : qu’est-ce que ces personnes peuvent nous apporter ? (si nous attendons d’elles quelque chose, il y a plus de chances pour qu’une vraie place leur soit faite).
- c) En quoi la fraternité et le souci des plus fragiles peuvent-ils aider l’Église à être davantage missionnaire ?
Je crois qu’il faut aussi entendre les objections qui peuvent être faites à l’encontre d’une importance trop grande qui serait donnée à la solidarité, dans l’Eglise.
On peut penser : est-ce vraiment la mission de l’Eglise que d’aider des personnes en difficulté ? Est-ce qu’elle ne risque pas de se transformer en ONG ou bien en service social ? Sera-t-elle encore l’Eglise ?
Ne risque-t-on pas d’aller vers une sorte d’activisme ? (avec tout le côté épuisant que cela peut entraîner) De devenir des « Marthe » au détriment de « Marie » ?
Et puis, si l’on s’engage dans le domaine social, on sait bien qu’on ne peut faire de l’évangélisation à tout crin, parce qu’on sent qu’il est difficile d’associer la relation d’aide (avec quand même, une sorte de dépendance qu’elle entraîne) avec la proposition de l’Evangile. Alors, est-on encore fidèle à la mission de l’Eglise ?
Voilà donc notre programme : répondre aux trois questions soulevées à l’instant, sans oublier les objections que je viens de rappeler.
Pour apporter au moins des éléments de réponse à ces trois questions, je vous propose de revenir aux fondamentaux de la foi. En commençant par s’arrêter sur la personne du Christ : comment, lui, vit-il sa mission ? Quand nous avons des questions sur l’Église, je crois qu’il est bon de nous référer à Celui qui, pour tout chrétien, tient la première place : le Christ.
Ça devrait nous donner de quoi revenir à nos 3 questions…
1- Jésus se présente comme un envoyé
Première chose, tout à fait fondamentale : Jésus est présenté comme un envoyé : lors de son baptême, par exemple, il y a cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (Mt 3,17) : Jésus est là par la volonté d’un autre ; il n’est pas quelqu’un qui vient de lui seul. Il ne roule pas pour lui, pour son fonds de commerce.
Ce trait est nettement affirmé dans l’Evangile de Jean et il revient comme un refrain : le Christ rappelle à plusieurs reprises qu’il vient faire la volonté du Père : Jn 4,34 : « ma nourriture c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » ; au chap suivant : « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jn 5,30) ; et encore au suivant « je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jn 6, 38)
Dans le Nouveau Testament, il y a un autre mot, qui dit pratiquement la même chose, c’est le mot serviteur (un envoyé, c’est un serviteur, quelqu’un qui est là tout entier de la part d’un autre) ; en grec : un diakonos (d’où vient « diaconie » et « diacre »).
Celui qui se met à la suite du Christ est appelé à la même expérience.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Peut-être ceci : un chrétien n’est pas, n’est plus un propriétaire. Toute sa vie est portée par un autre ; elle vient de Dieu ; tous les biens qu’il a, les qualités qu’il a, ça vient de plus loin que lui, ça le dépasse.
En fait, cela change beaucoup notre manière de vivre : parfois on est habité par l’angoisse de l’évaluation de ce que nous faisons, et à partir de là, de nous-mêmes :
- Que valent les prestations que je peux faire ? (on peut les évaluer selon différents critères)
- Qu’est-ce que je vaux, moi-même ? (là aussi différents critères et différentes échelles de grandeur peuvent être sollicitées)
Ce qui amène deux question redoutables :
- qui suis-je finalement ?
- Ai-je ma place dans ce monde ?
Beaucoup de nos contemporains sont taraudés par ce genre d’angoisses ; elle provoque parfois des souffrances graves (elle peut conduire au désespoir). Ça va se traduire notamment par la comparaison et la compétition : comment je suis placé par rapport aux autres ?
La manière d’être du Christ, celle d’un serviteur révèle un secret, une clé pour l’existence. Et celui qui, à la suite du Christ, reçoit sa vie de Dieu est libéré de l’angoisse de devoir se prouver ce qu’il vaut et donc aussi de s’imposer aux autres. C’est un homme humble. C’est un homme qui peut garder les mains ouvertes. Quand il rencontre des personnes, il peut être vraiment entièrement présent à elles, parce qu’il n’a rien à prouver sur lui-même. Il est tout entier disponible pour l’autre.
Jésus le sera même tellement, que le dernier soir de sa vie, au moment de dire adieu à ses compagnons, le geste qu’il trouve pour leur redire ce qu’il n’a cessé de vivre, c’est celui de prendre de la nourriture, du pain et du vin, et de leur donner comme son corps et son sang (et comme on l’a vu, l’évangéliste Jean met ce geste en parallèle avec celui du lavement des pieds : dans un cas, l’attention est focalisée sur le geste d’offrande de soi du Christ, dans l’autre, sur le type de relation que cela engage vis-à-vis de ceux à qui il s’adresse : un prendre soin qui commence par ce qui est le moins valorisé chez l’autre).
Un envoyé, c’est quelqu’un qui peut garder les mains ouvertes, qui peut donner, qui peut se donner, car il est libéré de l’angoisse de lui-même.
Et c’est cela aussi, qui fait que le Serviteur, l’envoyé, peut réconcilier les hommes entre eux, et faire naître une communion : en se présentant de cette manière-là, il permet à chacun d’être lui-même, et chacun, du coup, retrouve sa place par rapport aux autres. L’envoyé permet ce type de réconciliation.
<=> Notre guide, notre Seigneur, notre grand frère, c’est un serviteur, c’est quelqu’un qui a conscience de se recevoir tout entier d’un autre et qui est vraiment disponible vis-à-vis de ceux qu’il rencontre, prenant soin d’eux, et allant jusqu’à se risquer pour eux, allant jusqu’au don de sa vie. Et cela vient rompre le système de compétition, de rivalité, pour permettre une communion.
2- Qu’annonce-t-il, cet envoyé ?
Pour l’instant, j’ai parlé d’une manière d’être ; elle-même dit déjà presque tout.
Mais on pourrait dire : « oui, mais quand même, c’est important de se demander ce qu’il est venu dire ; il était envoyé, d’accord, mais pourquoi ? Pour dire quoi ? »
C’est une très bonne question.
Supposez qu’un collègue à vous, ou quelqu’un de votre famille, ou un très bon ami à vous vous pose cette question « c’est quoi, en gros, le message du Christ ? » que lui répondez-vous ? Qu’est-ce que Jésus est venu annoncer ?
Plusieurs réponses se présentent. On pourrait dire :
- Jésus est venu prononcer un jugement (redire ce qui conduit à la vie et dénoncer ce qui conduit à la mort, au néant) ;
- il est venu appeler à la conversion (nous inciter à bouger en profondeur) ;
- il est venu proposer un chemin de bonheur (on peut penser ici aux béatitudes) ;
- il est venu annoncer le Royaume (une humanité et une création renouvelées quand elles sont visitées par Dieu) ;
- Il est venu pour nous pardonner et nous sauver (nous désignons le Christ comme notre sauveur) ;
- Et je crois, beaucoup de chrétiens seraient tout prêts à répondre à la question en disant simplement « il est venu nous apprendre à aimer ».
Toutes ces réponses sont justes (bien qu’on sente qu’il y a des accents différents ; de même qu’il y a plusieurs manières d’être chrétien). Mais quelle est la réponse la plus ample, celle qui est la plus à même d’héberger aussi les autres réponses ?
Pour moi, la réponse la meilleure, celle qui contient toutes les autres, c’est la suivante : Jésus est venu renouer les liens de l’alliance entre l’humanité et Dieu (c’est donc encore une autre réponse que celles listées jusqu’à présent)
Dire cela oblige à relire toute la Bible, tout l’Ancien Testament, où l’on voit, peu à peu, laborieusement, cette alliance prendre corps dans une histoire, dans l’histoire d’un peuple. Cela oblige à se redemander ce qu’est une alliance, quel intérêt ça a (y compris pour aujourd’hui).
L’alliance, dans la Bible, c’est ce lien établi, très fort, entre Dieu et son peuple, qui permet de dire « je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». C’est un lien dans lequel Dieu s’engage, dans lequel il se risque en personne, c’est un lien qui appelle, qui demeure même quand on n’y fait pas réponse, c’est un lien qui fait grandir, c’est un lien qui jamais ne boucle sur lui-même mais qui est toujours prêt à s’ouvrir à de nouveaux venus.
C’est une relation que l’on pourrait résumer à un « parce que c’est toi, mon peuple » c’est une relation qui n’a pas d’autre « parce que » que « parce que c’est toi ».
Voilà ce que le Christ est venu annoncer ; et c’est pour cela que, parmi ses disciples, il en choisit douze, comme s’il voulait restaurer le peuple d’Israël avec ses douze tribus. C’est tout son peuple que le Seigneur veut réconcilier avec Dieu. Voilà son message et sa mission.
C’est pour cela, que très vite Jésus s’entoure de disciples. Si ce qu’il annonce, c’est un peuple restauré dans son amitié avec Dieu, il ne peut pas l’annoncer tout seul. Il a absolument besoin de disciples, qui donneront une idée de cet embryon de peuple qui va naître. D’ailleurs, regardez, dans l’évangile de Marc, tant que Jésus est seul, sa prédication se résume à une seule phrase : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). Et puis, dans le même évangile, au chap. 6, quand Jésus envoie ses disciples en avant dans les hameaux et les villages, on cesse de suivre Jésus dans sa mission, la caméra se tourne vers Hérode et vers Jean le Baptiste pour raconter comment ce dernier est mort : l’évangéliste ne veut pas, ou ne peut pas nous montrer Jésus seul. Pour lui, Jésus n’est pas pensable sans les disciples.
3- Il y a toujours des intrus !
Je résume le point où nous en sommes arrivés :
Jésus, notre grand frère et notre guide, est un serviteur, un diakonos, quelqu’un qui vient de la part d’un autre, pour annoncer l’Evangile d’une nouvelle alliance avec Dieu, qui va faire naître un peuple de Dieu.
On pourrait presque s’arrêter là, maintenant et dire : nous avons nos réponses à notre question sur l’importance de la fraternité dans la vie chrétienne : on voit bien que c’est central, puisque le message de Jésus, c’est le renouement de l’alliance ; ça veut dire qu’en renouant avec Dieu, grâce au Christ, nous nous redécouvrons frères et sœurs (nous nous découvrons bénéficiaires du même lien qui fait de nous des frères et des sœurs).
C’est vrai, et pourtant dans les évangiles, ça n’est pas si simple.
Pourquoi ? Parce que, partout où Jésus passe, partout où il est en train d’appeler à cette vie nouvelle réconciliée avec Dieu, eh bien il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu (c’est ici que commence la « théologie de l’imprévu !). Il y a sans cesse des hommes et des femmes en détresse, à cause de ce qui leur arrive ou bien de ce qui arrive à leurs proches, qui viennent le supplier de faire quelque chose (de manière parfois spectaculaire, parfois discrète, comme la femme hémorroïsse qui vient par derrière toucher la frange du vêtement de Jésus). Et puis il y a des possédés, des êtres qui crient, qui gesticulent, qui menacent, qui font peur, qui, sans cesse, viennent tout mettre sens dessus dessous (par exemple dans l’Evangile de Marc au chap. 5, le possédé de Gérasa).
Face à ces deux sortes d’intrus, on sent que les disciples sont soit déboussolés (ils ne savent plus quoi faire, sur quel pied danser), soit ils sont énervés. On le voit à certains endroits, par exemple dans l’Evangile de Matthieu, au chap. 15 quand une femme cananéenne houspille Jésus, les disciples disent « renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris » (Mt 15,23). De même pour Bartimée (Mc 10, 46 ss et //).
Mais Jésus, lui, accueille aussi ces personnes. On a même l’impression en lisant les évangiles, qu’il passe le plus clair de son temps avec elles. Et lui-même, au moment de se présenter, a dit, reprenant la prophétie d’Isaïe
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » (Lc 4, 18-19). Le message qu’il a à annoncer concerne d’abord ceux qui vivent au bord du monde, ceux qui sont menacés de disparaître du champ de nos échanges. Et de fait, si dans le texte des Evangiles vous supprimez tous les suppliants et les possédés, il ne vous reste plus grand monde : votre évangile est radicalement dépeuplé.
Est-ce que ça voudrait dire que l’Évangile a vraiment besoin de ces personnes pour faire entendre son message ? Oui, je crois qu’on peut dire cela. Car alors, on entend vraiment la puissance de son message et l’autorité du Christ.
Au sujet de ces personnes surgies de manières inattendues, on peut dire deux choses :
D’une part, ils interviennent sans se soucier de ce qui se fait habituellement : une femme vient en plein repas briser un vase de parfum sur les pieds de Jésus, les amis d’un homme paralysé se mettent à défaire la toiture parce qu’ils tiennent absolument à ce que Jésus le voie ; une femme vient, par derrière, toucher Jésus alors qu’il va, de toute urgence auprès d’une enfant qui meurt ; Bartimée crie tout ce qu’il peut pour que Jésus l’entende.
Lorsque ces hommes et ces femmes rencontrent enfin Jésus, il n’est pas rare que celui-ci leur dise : « ta foi t’a sauvé ».
Il n’y a qu’à ces personnes que Jésus dit cela. On ne l’entend jamais, par exemple dire des choses semblables aux disciples. A ceux-ci, au contraire, on l’entend faire le reproche d’être « lents à croire ».
Quand Jésus loue la foi de ceux qu’il rencontre (dans les synoptiques) :
| « Ta foi t’a sauvé » | Mt 9, 22 : la femme hémorroïsse (// en Mc 5, 34 et Lc 8, 48)
Mc 10,52 : Bartimée (// en Lc 18, 42) Lc 7,50 (la femme pécheresse chez Simon) Lc 17, 19 : le 10e lépreux |
| « Femme ta foi est grande ! » | Mt 15, 28 : la cananéenne |
| « voyant leur foi Jésus dit… » | Mt 9, 2 : le paralysé porté par quatre hommes (// en Mc 2, 5, et Lc 5, 20) |
| « Chez personne je n’ai trouvé une telle foi en Israël » | Mt 8, 10 : le centurion qui supplie pour son enfant (// Lc 7, 9) |
4- L’Église est revigorée par les personnes en détresse
On dirait que Jésus prend ces personnes en détresse, ces suppliants, comme modèles de croyants ; et il les désigne comme tels pour ses disciples.
Si c’est vrai, est-ce que ça ne veut pas dire qu’autour de nous, il y a certainement des personnes en détresse, qui sont dans cette attitude de supplication ; et de ces personnes-là nous pouvons apprendre ce que c’est que croire.
Peut-être parce que ces personnes sont comme tout entières rassemblées dans leur cri, dans leur supplication. Nous autres, quand nous nous adressons à Dieu, nous nous en remettons rarement entièrement à lui. Mais quand nous communions aux attente brûlantes de ces suppliants, alors, nous vivons quelque chose d’une foi entière, sans reste. De leur part, nous pouvons apprendre cela.
Tout à l’heure je posais la question : que pouvons-nous attendre des personnes en grande précarité ? Eh bien voici quelque chose qui n’est pas un petit rien.
Mais en même temps, nous pressentons que pour pouvoir nous laisser rejoindre au plus profond de nous par les supplications de ces personnes, ça va nous demander un sacré dépouillement, ou disons, un chemin d’ouverture et de simplicité. Parce qu’il y a au fond de nous, des tas de choses qui ne veulent pas du tout entendre ces cris ni se laisser toucher.
Nous recevons un grand trésor de la part des suppliants !
Et les possédés ? Que recevons-nous d’eux ?
Regardons par exemple le récit de la guérison du possédé de Gérasa. Voici un homme qui représente un peu tout ce qui fait peur aux habitants de Gérasa. Il est impossible à dompter ; il vit dans les tombeaux (tout près des morts) ; il se promène le jour et la nuit en hurlant ; il se taillade avec des pierres. Cet homme, c’est une sorte de plaie vivante. Il concentre ainsi sur lui tout ce dont la ville a peur, tout ce qu’elle rejette, tout ce dont elle veut se débarrasser.
Jésus, lui, quand il l’a rencontré, n’a pas cherché à le maîtriser comme l’avaient fait les habitants de cette ville, il n’a pas regardé d’abord les démons, mais il a regardé cet homme perdu au milieu de cette légion d’esprits mauvais. On pourrait dire : Jésus, en cherchant cet homme, est passé par-dessus tout ce qui impressionnait, il n’a cherché à atteindre aucun objectif avec cet homme, la seule chose qui l’intéressait, c’était lui. Et le résultat c’est qu’à la fin, cet homme est assis, vétu, et dans son bon sens. Or les habitants de la ville, en voyant cela, ont peur…
On peut dire : Jésus recherche cet homme sans autre pourquoi que « parce que c’est toi » ; autrement dit, avec lui aussi, il cherche à vivre quelque chose de l’alliance (comme quoi, cette logique d’alliance peut se décliner dans différents types de rencontres, à différentes échelles).
Voilà une 2e chose qui nous est donnée dans la rencontre avec les personnes en grande détresse, qu’elles soient des « suppliants » ou des « possédés » : ils nous obligent à mettre au premier plan le lien de l’alliance : « parce que c’est toi ».
Ce sont des guides vers l’alliance
Voilà pourquoi l’Église perd beaucoup de sa force et de son énergie quand elle oublie les malades, les pauvres, les hommes et les femmes en détresse, suppliant au milieu de leur misère, ou prisonniers de celle-ci, possédés par elle. Elle devient une Église tranquille, plan-plan, et elle annonce un Evangile de confort, un Evangile simplement pour vivre mieux. Elle n’est plus confrontée plus aux questions de vie et de mort.
C’est tout simplement cela que l’Église perd quand elle s’éloigne de ses frères en détresse. Annonce-t-elle encore, dans ces conditions, le salut ? Oui bien sûr, mais avec le risque de l’annoncer sous une forme édulcorée, une forme qui ne nous dérange quand même pas trop. Et qu’est-ce qu’une Église qui n’annonce plus le salut ?
Je ne dis pas que c’est facile ! Et je dis encore moins que l’Église a failli à sa mission, car de manière très belle et forte, il y a toujours eu des chrétiens auprès de leurs frères en détresse, et d’ailleurs, ils ont souvent fait preuve d’une très étonnante créativité !
Ici, nous avons aussi recueilli, je crois, quelque chose pour répondre à la troisième des questions posées pour commencer : la fraternité et le souci des plus fragiles peuvent-ils aider l’Église à être davantage missionnaire ?
Mais on peut aborder encore un autre aspect : le chemin fait avec les personnes en détresse peut-il aussi aider l’Église à être davantage fraternelle (et l’on pourrait dire aussi synodale ; càd capable de faire place à chacun pour qu’il apporte sa contribution propre à la vie de l’Eglise) ?
A la lecture des Evangiles, on peut remarquer une chose :
- les disciples sont présentés comme étant préoccupés par la question : « qui est le plus grand ? » Dans l’Évangile de Luc, cette question vient se glisser jusque dans le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Signe qu’il s’agit sans doute d’une question indéracinable. Elle reviendra toujours. Ne rêvons pas d’une Église de parfaite fraternité. Or cette course à la grandeur, évidemment, c’est un sérieux frein pour la fraternité, car elle va provoquer de la peur mutuelle et empêcher que chacun puisse apporter sa contribution, même si elle est très modeste, à la vie de l’Église.
Qu’est-ce qui peut nous aider, je ne dis pas à laisser de côté totalement ce souci de grandeur, mais au moins à le relativiser (c’est-à-dire à lui interdire d’occuper toute la place) ?
Je crois que le chemin fait avec les personnes les plus vulnérables, desserre le souci de la grandeur : les enfants, les malades, les pauvres, l’étranger.
Ces personnes ont en commun de pouvoir difficilement prétendre aux bonnes places dans la course à la grandeur.
Or, chaque fois qu’il m’est donné de vivre quelque chose d’heureux avec ces personnes, c’est le signe que la joie, la vraie, celle qui fait vivre, celle qui vient de Dieu, ne vient pas de mes victoires dans la course aux grandeurs, mais de ce que nous pouvons découvrir ensemble.
Alors, les bases sont posées pour une fraternité / synodalité qui autorise chacun à apporter sa pierre à la construction de l’Église.
La Bonne Nouvelle passe par mon frère. Mais vous voyez, il faudrait ici préciser : par mon frère qui crie vers Dieu, et par mon frère qui ne parvient pas à s’en sortir. C’est que la fraternité chrétienne, ce n’est pas une fraternité simplement entre nous, les disciples. C’est une fraternité sans cesse rouverte et provoquée (dans les 2 sens du mot), surtout par des suppliants et des possédés. Elle doit faire le détour d’une histoire avec les suppliants et les possédés pour devenir vraiment fraternité en Christ, lui, qui sur la croix, est allé jusqu’à les rejoindre tout entier.
Comment tout cela peut-il se décliner dans la vie d’Eglise ?
Voici quelques pistes, à partir surtout de la réalité paroissiale :
- A partir de l’ordinaire de la pastorale :
- Quelle attention avons-nous aux membres de nos communautés qui traversent un passage difficile (maladie, chômage, difficultés familiales, etc.) ?
- Comment nous préparons-nous à accueillir le tout venant, et d’abord celui qui « présente mal » ?
- En s’appuyant sur ce que vivent les chrétiens qui ont un engagement solidaire (dans un cadre associatif, professionnel, ou politique)
- Comment nous aidons-nous à relire ce qu’ils vivent, afin de ne pas passer à côté des découvertes qu’ils peuvent faire ?
- Pourrions-nous envisager qu’ils partagent (sous une forme à imaginer) quelque chose de leurs découvertes à la communauté chrétienne ?
- Peut-être peuvent-ils aussi aider la communauté à mieux connaître son environnement (notamment les misères cachées qui le marquent).
- Comment la communauté peut-elle rejoindre les combats de ces personnes par sa prière ?
- De même vis-à-vis des institutions de la solidarité (hôpital, maisons de personnes âgées, maisons d’arrêt, aire de stationnement de gens du voyage etc.) situées à proximité de la communauté ou sur son territoire.
- Ne pas avoir peur d’appeler des membres de la communauté eux-mêmes en précarité à exercer des responsabilités qu’ils peuvent assurer
- Réfléchir à telle ou telle initiative à prendre, si la communauté détecte un besoin fort là où elle est. Ce peut être pour celle-ci une manière de donner consistance à son désir de solidarité.
Etienne Grieu sj,
Centre Sèvres, Facultés Jésuites de Paris
Donné à Fribourg, mercredi 30 janvier 2019